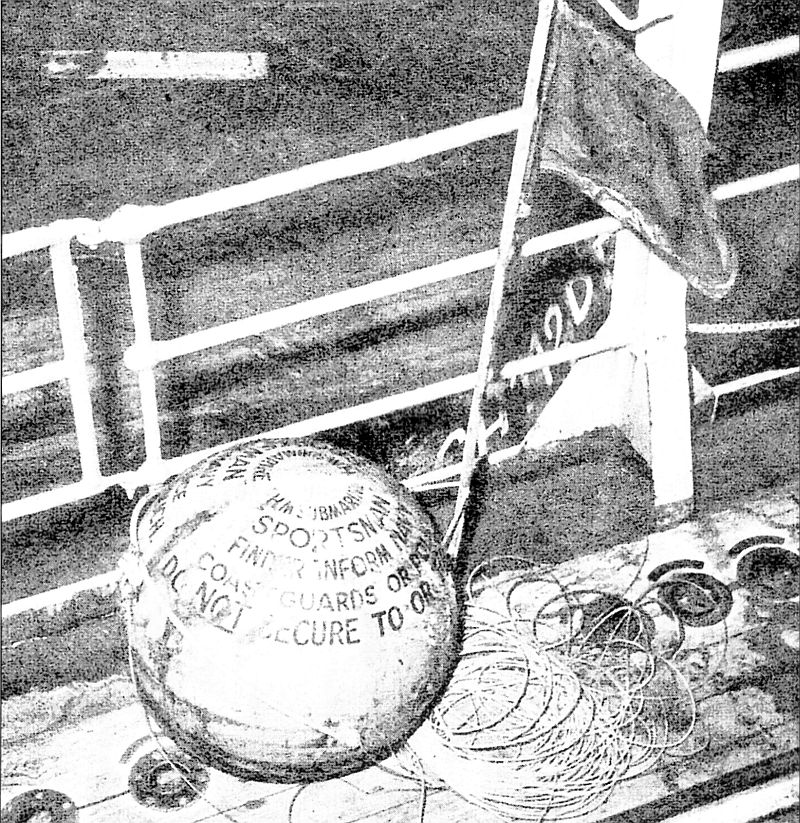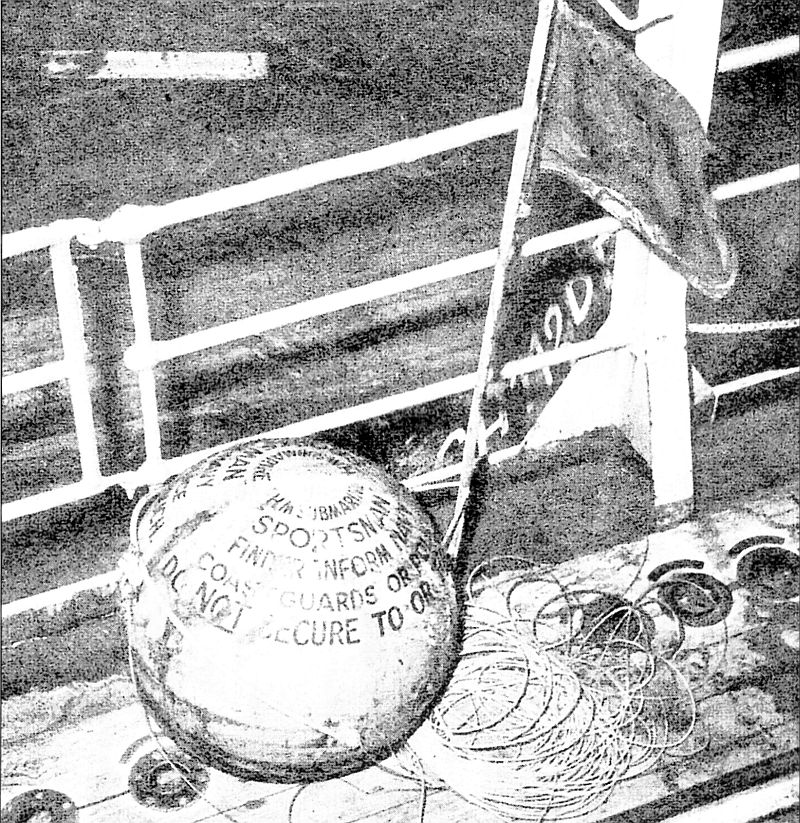Le naufrage de la Sibylle II
par Michel Pontrucher
- En vue de son prêt à la Marine
nationale, le sous-marin H.M.S. Sportsman est sorti de
mise en réserve en 1951. Il sera la dernière des
quatre unités du type S prêtées dan le
cadre de l'OTAN à rallier à la France. Après
une formation très complète pour le noyau
d'armement, celui-ci devenant à son tour instructeur
lorsque le complément d'équipage ralliera, le
changement de pavillon a lieu le 13 juillet 1952 dans la base des
sous-marins à Gosport. Bien entendu, le changement de
pavillon a déclenché un nouveau baptême, et
désormais, il est devenu le sous-marin
Sibylle.
- Le bâtiment ayant été recetté au
préalable, dès la fin juillet 1952, il peut
appareiller pour rallier Toulon, son port d'affectation. La
première escale est Brest, puis ensuite cela sera Lorient
et Casablanca. Durant le transit Casablanca-Alger, lors d'une
plongée de routine, il y eut un incident sous la forme de
prise d'une forte pointe négative. Le bâtiment fut
contrôlé en vue de sa remontée et il
semblerait que cela était imputable à une
méconnaissance du personnel. Ensuite, ce sera Alger et
enfin Toulon, où il se présente à la base de
sous-marins dans sa livrée bleu foncé d'origine,
caractéristique des sous-marins britanniques
opérant en Manche et en Mer du Nord. Assez rapidement, il
sera uniformisé avec les autres bateaux avoisinants en
recevant une couche de peinture « bleu
Méditerranée » mais qui, en fait, est noire
puisque s'appelant également « négroline
». Il prend alors rang dans les activités de la base
et est dirigé assez rapidement vers des exercices.
- En fait, ce qui peut être raisonnablement écrit
sur la disparition est obligatoirement bref en égard
à la discrétion totale de la perte.
- Comme dit, le sous-marin Sibylle était
incorporé dans le cadre global d'un exercice d'escadre
placé sous les ordres de l'amiral Pothuau et ayant pour
thème « Attaque par une force ennemie venant du
large de rivages de Provence ». En ce mercredi 24 septembre
1952, plus précisément il exécute avec le DE
Touareg un exercice d'attaque par escorteur d'un
sous-marin naviguant à une immersion de - 30 m avec un
changement de route de 30° toutes les 10 minutes. Au cours de
la deuxième attaque, à 08h02, le contact asdic est
perdu à 270 m de distance, soit un peu avant que
l'escorteur n'arrive à sa verticale. Ce sera là la
dernière manifestation de sa présence active.
Aussitôt les premières recherches s'organisent et
les grands bâtiments sur place, très peu
équipés pour la détection ASM, doivent
laisser les escorteurs opérer par ratissage de zone.
Dès 12 heures, les premiers éléments
aéronavals en provenance du PA Lafayette viennent
apporter leur aide.
- Vers treize heures, il y a découverte de la bouée
téléphonique, élément dont de ce type
de sous-marin était pourvu. Il s'agissait d'une
sphère en matériau à très forte
flottabilité, d'un diamètre de 0,70-0,90 m, peinte
en couleur jaune très vif et marquée du nom du
bâtiment et de diverses inscriptions en langue anglaise.
À l'intérieur de cette sphère était
ménagée une petite enceinte étanche
contenant un téléphone
auto-générateur. À sa base, un câble
téléphonique d'une longueur de 200 m était
censé assurer la liaison avec le bâtiment. En partie
haute, la sphère était surmontée par un axe
formant hampe pour un petit pavillon de couleur rouge
foncé en tissu imperméabilisé. En position
de repos, cette bouée avait un logement dans la
superstructure du pont et pouvait être larguée de
l'intérieur du sous-marin. Malheureusement, dans le cas
présent, la bouée fut
récupérée avec le câble
téléphonique rompu. Y a-t-il eut arrachement par la
forte flottabilité ou la profondeur atteinte lors du
largage était-elle déjà supérieure
à 200 m ? Nul ne sait, toujours est-il que ce maigre
vestige n'apportera aucun indice exploitable, hormis celui de
faire comprendre que l'irrémédiable avait du
survenir.
Bouée téléphonique de la Sibylle
(DR)
- Vers quinze heures, un petit avion venant
du côté large et devant se poser sur un
aérodrome du littoral signale avoir survolé une
zone irisée et en donne le relèvement. Force est de
constater que de tels indices, et ce seront les seuls, confirment
ce qui avait été pressenti et ce d'autant plus
qu'en cette zone au large du cap Camarat, le plateau continental
est très vite quitté et que les fonds y atteignent
rapidement des profondeurs de - 700 m, immersion totalement
démesurée pour ce type de sous-marin. Il faut noter
que cette tragédie a lieu 41 ans, jour pour jour,
après l'explosion à Toulon du cuirassé
Liberté qui fit 600 morts, la cause étant
l'instabilité des poudres colloïdales (base des
munitions). Dans le cas présent, 48 hommes venaient
d'être englouti avec leur navire.
- Le 26 septembre, le secrétaire d'État à la
Marine, Monsieur Gavini, entouré de tout
l'état-major général se rend sur le croiseur
Gloire, alors bâtiment-amiral, pour rendre hommage
en mer aux victimes. Deux colonnes distantes de 900 m se forment
pour gagner le lieu présumé de la disparition. Dans
l'une, on trouve les croiseurs Gloire, Montcalm,
Georges Leygues, le destroyer-escorteur Marceau,
dans l'autre, le ravitailleur pour sous-marins Gustave
Zédé, les escorteurs Arabe,
Kabyle, Touareg, Soudanais,
Sénégalais, Berbère,
Malgache. À 13h30, les navires atteignent le lieu
présumé du naufrage lequel se situe à 6,5
miles à l'ouest du cap Camarat. C'est par une mer quelque
peu agitée que les équipages, en tenue de sortie et
aligné au po: te de bande, rendent hommage à leurs
camarades disparu en respectant une minute de silence
après que les clairons eurent exécutés la
sonnerie « Aux mort ». Le 27 septembre, ce sera alors
à terre, avec les mêmes personnalités,
l'hommage des familles, de la Marine, et de la ville de
Toulon.
- II est bien compréhensible qu'un tel accident
éprouve très fortement les personnes proches par la
parenté ou même par le lien existant entre les
équipages. On se contentera ici d'examiner ses
répercussions sur un plan global.
- L'arme sous-marine d'après-guerre, déjà
éprouvée par la disparition de I'U-2326 le 5 décembre 1946,
est à nouveau endeuillée en ce 24 septembre 1952
par la perte de 48 de se membre. Il est aisé de comprendre
que cela est très lourd dans ce milieu assez clos,
où tous les hommes se connaissent de bord à bord
même s'ils n'ont jamais navigué ensemble. En fait,
la vie identique, et les problèmes communs les soudent, y
compris dans le malheur. En excluant totalement le
côté humain des deux tragédies, la
disparition du sous-marin Sibylle a été
moins lourde de conséquence sur le plan technique que
celle du sous-marin U-2326 ; en effet, sur ce dernier il y
avait en jeu un savoir à découvrir, puis à
exploiter pour les constructions navales et par voie de
conséquence pour la Marine et la défense
éventuelle du pays. Par contre, dans le cas de ce
sous-marin prêté comme bâtiment de combat, mai
n'en ayant plus les pleines capacités en égard de
l'âge de sa conception et même de sa
réalisation, l'incidence fut bien moindre.
- Concrètement, pour marquer sa confiance dans le
matériel employé, le secrétaire
d'État à la Marine effectua le 9 février
1953 une plongée à bord du sous-marin
Saphir. Les mesures de sécurité furent
renforcées à bord des trois unités
restantes, et, en particulier, les tubes lance-torpilles du
sous-marin Sirène, un type S identique à la
Sibylle par différence aux deux autres type
S dit « rapides », furent condamnés. Il
a en effet été vu dans le texte de cet ouvrage que
les sous-marins type S « rapides » Sultane et
Saphir avaient été livrés
démilitarisé. Sur ce sujet, il faut savoir que la
manœuvre des tubes lance-torpilles sur le sous-marin de
type S était différente de celle sur les
sous-marins français et allemands constituant le reste de
la flotte de transition, en particulier les
sécurités entre portes avant et arrière des
tubes qui étaient notablement simplifiées.
- Les moyen d'investigation sous l'eau s'étant
spectaculairement développés en 15 ans, et
continuant depuis, ce n'est qu'en 1967 que l'épave de la
Sibylle a été repérée avec
précision. Elle se trouvait sur le lieu qui était
déjà le lieu présumé
déterminé en 1952, soit sur des fonds d'environ -
700 m.
- Un monument commémoratif a été
élevé à la pointe du cap Camarat face
à la mer.
Glossaire
Source : 1944-1954 SOUS-MARINS FRANÇAIS La
décennie du renouveau.