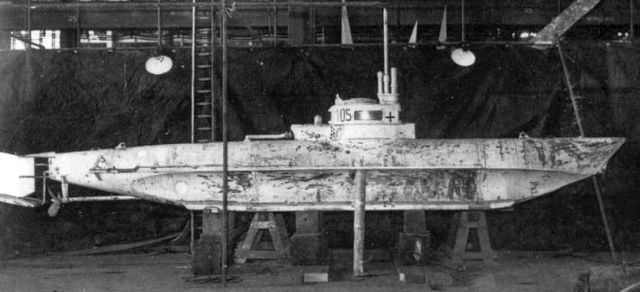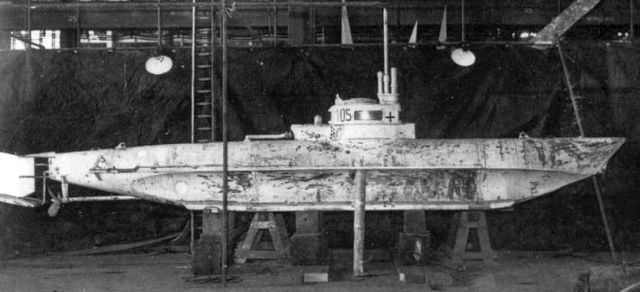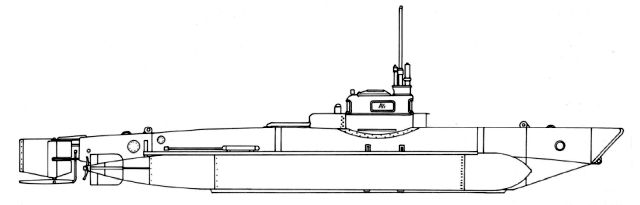Biber
Biber
Silhouette du Biber
Développement,
construction, essais
- Contrairement au Hecht, le
Biber (castor) est une idée nouvelle lancée
par le KKpt Hans Bartels (FKpt à partir du 01
Décembre 1944), un officier d'état-major du
K-Verband. Bartels base sa conception sur le sous-marin de
poche britannique de type Welman
W-46, capturé à Bergen le 22 Novembre 1943.
Le Welman est techniquement inachevé et un petit
bateau dangereux, mais Bartels pense qu'il peut être
considérablement amélioré.
- Le 04 Février 1944, Bartels et le Kptlt (S) Michael
Opladen, officier de l'Abwehr issu d'une famille d'industriels,
négocient avec le directeur Bunte de Flenderwerft
à Lübeck la construction de son concept de sous-marin
de poche. Le 23 Février, le projet provisoire,
baptisé Adam et Bunte-boat, est sur la table
et le 15 Mars, le prototype Biber, comme on l'appelle
officiellement, est achevé par le chantier
Flender.
- Les premiers essais, auxquels Bartels participe
personnellement, ont lieu sur la rivière Trave. Au cours
d'une des premières plongées, le bateau coule avec
Bartels à bord. Il survit, le bateau est renfloué
et rapidement restauré. Le 27 Mars, Dönitz accepte
personnellement le bateau dans la Kriegsmarine. Les doutes
exprimés par le conseil de construction navale
(Hauptausschuss Schiffbau der Kriegsmarine) concernant
l'utilisation d'un moteur à essence sont
écartés par le directeur Bunte en faisant observer
qu'il offre une capacité illimitée et fonctionne
silencieusement. L'OKM commande quatre prototypes suivis d'une
commande en série de vingt bateaux d'entraînement et
de 300 bateaux opérationnels.
- Les coques et les accessoires sont fabriqués par
Flenderwerft Lübeck et le chantier italien
Ansaldo à Gênes. Ce dernier expédie
les coques pour finition à l'usine
Klöckner-Humboldt-Deutz à Ulm. En Mai 1944,
trois, en Juin dix, en Juillet dix-neuf, en Août cinquante,
en Septembre 117, en Octobre soixante-treize, en Novembre
cinquante-six bateaux sont achevés et livrés au
K-Verband.
- Le Biber est constitué de trois sections
boulonnées ensemble. La section avant et une partie de la
section arrière contiennent les principaux ballasts. La
salle de contrôle se trouve entre les deux cloisons et
accueille le pilote assis, la tête dans la tourelle de 0,71
mètre de diamètre, dont la partie supérieure
ne dépasse que de 0,51 mètre de la surface par
temps calme. Des hublots d'observation sont installés dans
cette tourelle et un périscope est utilisé en
plongée. Le pilote fait face au tableau de bord,
économe en espace et limité à l'essentiel.
Pour plonger, il doit effectuer seize mouvements de la main. La
salle de contrôle contient des réservoirs d'air
comprimé pour gonfler les bouteilles de plongée, la
bouteille d'oxygène et l'équipement respiratoire,
les batteries, les réservoirs d'essence et les conduites
de carburant vers le moteur. Le pilote ne dispose d'aucun
équipement personnel. Pour se nourrir, il a une ration de
chocolat mélangé à une pilule de peps pour
conjurer le sommeil lors des longues opérations (Médicaments).
- Le moteur de surface est le controversé moteur 2,5 Otto
de 32 ch, conçu à l'origine pour le camion Opel
Blitz, qui donne au Biber une autonomie de 100 nautiques
et une vitesse de pointe de 6,5 nœuds. Les gaz
d'échappement contiennent du monoxyde de carbone et le
pilote crée donc une atmosphère mortelle s'il
laisse le moteur tourner plus de 45 minutes avec le panneau
fermé. L'accumulation de gaz toxique le submerge alors, il
s'endort et succombe à l'environnement empoisonné.
Un certain nombre de pilotes sont morts d'intoxication au
monoxyde de carbone lors de missions opérationnelles.
L'appareil respiratoire du pilote est suffisant pour vingt
heures. Il s'agit d'un masque nasal-bouche avec un tube menant
à trois cartouches de potasse pour purifier ses
expirations de dioxyde de carbone.
- Pour tenter de réduire le nombre de décès
par empoisonnement, Bartels met sur pied une unité
composée d'officiers de marine, de techniciens,
d'ingénieurs et d'un médecin pour étudier
les effets de l'inhalation des gaz d'échappement de
l'essence. Les symptômes sont des étourdissements,
une torpeur et des acouphènes. Après avoir
respiré de l'air frais, des maux de tête intenses
apparaissent derrière le front, suivis de vomissements. On
martèle aux pilotes de Biber qu'ils doivent
s'assurer que la vanne du tuyau d'échappement est
fermée ; si elle reste ouverte, la concentration de
monoxyde de carbone dans le bord atteint des proportions
mortelles (1,2VO%).
- Trois racks, chacun constitué de quatre batteries de
type 13T 210, fournissent l'énergie nécessaire
à un moteur électrique de 13 CV. L'autonomie est de
8,6 nautiques à 5,3 nœuds à 20 mètres
de profondeur. La coque épaisse est en tôle d'acier
de 3 mm garantie jusqu'à une profondeur de 20
mètres. La coque est résistante à la
pression jusqu'à 40 mètres et plusieurs pilotes de
Biber constatent au cours des opérations que cette
pression peut être facilement dépassée. Les
cloisons intérieures et trois nervures longitudinales
renforcent le bordé de la coque.
- Le Biber n'a pas de réservoirs de compensation ou
d'équilibrage, seulement des réservoirs de
plongée dans les compartiments avant et arrière
pour l'enfoncer en cas d'urgence. Le bateau ne mérite donc
pas d'être appelé sous-marin. Il se comporte
bien en surface, mais immergé, il est presque impossible
de le diriger dans n'importe quel axe, principalement parce qu'il
ne peut pas être réglé. Par
conséquent, seules les attaques en surface sont possibles,
l'immersion permettant d'éviter les attaques et de
s'échapper. Le bateau doit être ajusté
à l'aide d'un lest fixe avant chaque départ. En
cours de route, les changements de déplacement ou
d'assiette ne peuvent être compensés qu'en inondant
partiellement les réservoirs de plongée. C'est une
tâche délicate pour le pilote, qui s'ajoute à
ses problèmes lorsqu'il fait plonger le bateau.
- L'armement est constitué de deux torpilles, chacune
suspendue à un rail et logée dans une cavité
moulée de chaque côté de la quille. Les
torpilles ont une puissance de batterie limitée pour
économiser du poids. Pour les tirer, le piston d'un
cylindre à air comprimé se relève
brusquement pour libérer une vis de pression et forcer
l'ouverture d'un levier de déclenchement sur la torpille.
Cela démarre le moteur de la torpille. Cette
dernière, maintenue à l'écart de la coque
par deux brides sur le rail de retenue, se déclenche alors
par ses propres moyens. Ce mécanisme de tir est primitif
et provoque de graves accidents. L'inattention lors du largage de
la torpille provoque la destruction d'un certain nombre de
bateaux et la mort de leurs occupants. En guise d'alternative aux
torpilles, le Biber peut transporter deux mines terrestres
activées par des détonateurs
magnétiques/acoustiques ou magnétiques/à
pression d'eau.
- D'autres développements du Biber qui sont
finalement restés au stade de la planification sont les
projets de Biber II et III à deux moteurs.
L'abandon de la conception a lieu après qu'une instruction
de l'OKM au début de 1945 ait mis fin à tous
les travaux sur les projets qui n'étaient pas encore en
production en série. Cette directive n'a pas
été suivie par tous. Le fait que l'Admiral Heye
occupait une position relativement indépendante a permis
de poursuivre les travaux sur les projets favoris jusqu'à
la fin de la guerre. Le Biber III est conçu pour
recevoir un moteur diesel de 60 ch (40 ch en circuit
fermé) au lieu du moteur Otto, ce qui lui confère
une autonomie de 1 100 nautiques à 8 nœuds. Le
projet est abandonné en faveur du Seehund et de la
nécessité, à l'époque, de disposer
d'un U-Boot de poche moderne.
- Flottilles des
Biber.
- Opération à
Fécamp.
- Flottilles de Biber en
Hollande.
- Flottilles de Biber en
Arctique.
Glossaire
Source : HITLER'S SECRET COMMANDOS